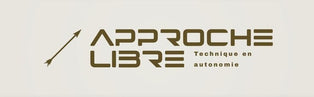La cuisine médiévale fascine autant qu’elle déroute. Entre les banquets pleins d’épices et les repas paysans frugaux, on se perd souvent dans les images d’Épinal. Pourtant, grâce aux manuscrits culinaires, aux archives comptables, aux fouilles archéologiques et aux traités d’époque, on peut aujourd’hui reconstituer de manière fiable les aliments consommés au Moyen Âge, entre le XIIIᵉ et le XVe siècle.
Voici une synthèse des pratiques alimentaires médiévales, centrée sur la France et les régions voisines.
Une cuisine fondée sur le grain
Comme dans l’Antiquité, le socle de l’alimentation médiévale reste le pain et les céréales. Le blé est réservé aux plus riches et aux villes, tandis que la campagne consomme surtout du seigle, de l’orge, de l’avoine ou du sarrasin, selon les régions.
Les céréales sont consommées sous forme de pain (pain bis, noir, blanc ou à base de méteil), de bouillies, de crêpes épaisses, de flans ou de farine pour lier les sauces. Le pain blanc reste un luxe réservé aux nobles et aux ecclésiastiques.
Légumineuses et légumes du potager
Les pois, fèves, lentilles, pois chiches et certains haricots (notamment à rames, importés d’Espagne) étaient courants. On les utilise dans les potages, purées ou plats mijotés.
Les potagers médiévaux fournissent toute l’année des légumes simples mais nourrissants : choux, navets, poireaux, carottes anciennes, panais, oignons, ail. On consomme aussi les fanes, les feuilles de betterave, le cresson, les orties et autres verdures.
La viande : abondante ou rare selon le statut
Les nobles consomment beaucoup de viande, souvent dans le cadre de banquets ou de repas codifiés : gibier (cerf, sanglier, lièvre, lapin), volailles nobles (cygne, paon, héron), et viandes d’élevage comme le bœuf, le mouton, l’agneau, et surtout le porc.
Le peuple se contente de porc, de volaille de basse-cour ou d’abats. La viande est souvent salée, fumée ou mijotée au chaudron. Les jours maigres imposés par l’Église interdisent la viande plusieurs jours par semaine : on consomme alors du poisson, des œufs, ou des produits laitiers.
La charcuterie et les techniques de conservation
La charcuterie est très présente dans la cuisine paysanne et citadine. On trouve du lard fumé, des boudins, saucisses, andouilles, pâtés, viandes confites dans leur graisse. La salaison, le séchage et le fumage permettent de conserver la viande plusieurs mois. Ces produits sont aussi intégrés dans les soupes et ragoûts pour les enrichir.
Produits laitiers : bien présents, mais variables
Le lait est rarement bu tel quel, mais transformé en lait caillé, faisselle, fromages frais ou affinés. Le beurre est surtout consommé dans les régions du nord, la crème dans certaines recettes nobles, et le petit-lait utilisé dans les soupes.
Les produits laitiers jouent un rôle important dans les régimes maigres prescrits par l’Église.
Fruits et sucreries naturelles
Pommes, poires, prunes, cerises, mûres, noix, châtaignes, noisettes sont courants. Les fruits peuvent être mangés crus, séchés, ou intégrés à des plats salés-sucrés.
Le sucre de canne est un produit de luxe importé, réservé à l’aristocratie. Le miel est plus courant et sert à sucrer, conserver ou aromatiser. Les confitures sont souvent médicinales à l’origine (électuaires), ou préparées dans des sirops épais.
Les épices : goût et prestige
La cuisine médiévale de la noblesse est réputée pour son usage généreux d’épices : poivre, gingembre, cannelle, clou de girofle, maniguette, muscade… Elles coûtent cher et symbolisent richesse et raffinement.
Ces épices sont utilisées dans les sauces, les plats mijotés au chaudron, et même les bouillies. Le goût recherché est souvent aigre-doux, avec l’usage de verjus, vinaigre, jus de fruits acides, ou d’herbes comme le persil, la sauge, la marjolaine ou l’hysope.
La cuisine au chaudron : cœur du foyer
Dans toutes les couches de la société, le chaudron est l’ustensile central. Suspendu dans l’âtre, posé sur un trépied ou directement sur les braises, il permet de cuire presque tous les plats du quotidien.
On y prépare :
— des soupes épaisses, potages, bouillies
— des ragoûts de viande, légumes et légumineuses
— des sauces épaisses à base de pain et d’épices
— des plats mijotés pendant plusieurs heures
La cuisson se fait sur un lit de braises, sans flamme directe, autour de 95 °C. C’est une cuisine de patience, de lenteur, mais aussi de grande efficacité : peu d’ustensiles, beaucoup de saveur et une cuisson uniforme.
Le chaudron est associé à la chaleur, à la survie, au partage.
Le pain et la soupe : piliers de l'alimentation
Certaines recettes paysannes permettaient de cuire du pain à la braise, directement dans le chaudron, en posant la pâte sur un fond de paille ou de feuilles. Le pain omniprésent est souvent trempé dans des soupes ou ragoûts. Chez les plus modestes, un repas consiste parfois uniquement en une tranche de pain noir trempée dans un potage.
La soupe, terme générique, désigne tout liquide chaud contenant pain, légumes, grains ou restes. C’est le plat le plus commun, partagé chaque jour autour du chaudron.
Boissons : vin, bière, cidre, hydromel
Le vin est très consommé, même coupé d’eau ou bouilli. Le peuple boit plutôt de la cervoise, de la bière (non houblonnée), du cidre, ou de l’hydromel. On trouve aussi des infusions d’herbes, et parfois des bouillons fermentés.
L’eau est rarement bue seule, souvent mélangée à d’autres ingrédients pour éviter les contaminations.
Une cuisine codifiée, rustique et savante
La cuisine médiévale est structurée par les saisons, les interdits religieux, les statuts sociaux, mais aussi par une grande capacité d’adaptation. Les manuscrits de cuisine nobles révèlent une cuisine inventive, raffinée, savoureuse. Mais la cuisine populaire, plus sobre, montre une grande créativité pour utiliser les restes.
La cuisson au chaudron est l’un des ciments de cette culture culinaire : simple, mais généreuse.
Vous pouvez dès maintenant commander vos coffrets de recettes Médiévales à réaliser vous-même au chaudron.
Tout le matériel est disponible sur le site pour vous lancer !

Pour aller plus loin :
– Le Viandier de Taillevent (XIVᵉ siècle), éd. T. Scully
– Le Ménagier de Paris (1393), éd. Brereton & Ferrier
– Odile Redon et al., La cuisine au Moyen Âge, éd. Stock
– Bruno Lemesle, « Le feu et la cuisine domestique au Moyen Âge », in Archéologie Médiévale, 2002
– Jacques Thirion, Le Chaudron et l’Alambic, CNRS