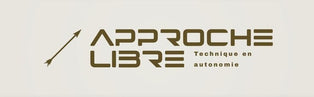Et si nous mangions comme les Gaulois ?
Avant la romanisation, les peuples celtiques vivaient au rythme d’une cuisine locale, sobre mais riche de saveurs. Grâce aux recherches archéologiques récentes, on peut désormais reconstituer avec justesse leur alimentation quotidienne. Oublions les caricatures, et replongeons dans un monde culinaire vieux de plus de deux mille ans.
Voici un panorama des ingrédients présents en Gaule à l’époque celtique (avant -52) et utilisés dans leur quotidien alimentaire.
Les céréales : base de l’alimentation
Les Gaulois étaient d’excellents agriculteurs et les céréales constituaient la base de leur régime alimentaire. Elles étaient consommées sous forme de bouillies épaisses, de galettes, de pains rustiques, intégrées à des ragoûts ou encore transformées en boissons fermentées.
Parmi les céréales attestées par l’archéologie, on retrouve l’orge vêtue (Hordeum vulgare, très fréquente), le millet (Panicum miliaceum, résistant et courant), ainsi que les blés vêtus : l’épeautre (Triticum spelta), l’amidonnier (Triticum dicoccum) et, plus marginalement, l’engrain (Triticum monococcum).
Le seigle (Secale cereale) et l’avoine (Avena sativa) sont également attestés, mais semblent avoir eu un rôle secondaire : le premier était probablement encore perçu comme une adventice, et la seconde servait surtout de fourrage pour les chevaux, bien qu’elle ait pu être consommée ponctuellement par les hommes.
En revanche, le blé tendre nu (Triticum aestivum), qui constitue aujourd’hui la base de notre alimentation, n’était pas encore cultivé en Gaule avant la romanisation. De même, aucune trace de maïs ou de riz n’existe dans la Gaule de cette époque.
Légumineuses
Les légumineuses jouaient un rôle essentiel pour équilibrer les repas : elles apportaient des protéines végétales et se conservaient bien toute l’année.
On retrouve surtout les fèves, les pois cassés, et dans une moindre mesure les lentilles. Les archéologues identifient aussi parfois de la gesse, de la vesce ou du lupin. Certaines graines comme le lin ou le pavot étaient utilisées, notamment pour l’huile ou en garniture.
Pas de pois chiches ni de haricots secs : ces derniers viendront bien plus tard, avec les échanges méditerranéens ou transatlantiques.
Racines, légumes et verdures
La Gaule offrait une belle diversité de légumes rustiques, adaptés au climat tempéré et aux moyens agricoles de l’époque.
Les Gaulois cultivaient ou cueillaient des navets, carottes anciennes, panais, choux frisés, oignons, ail, poireaux sauvages. Ils utilisaient aussi des verdures comme les orties, les fanes de navet, les feuilles de chou ou des herbes sauvages cueillies localement.
Il n’y avait bien sûr ni pommes de terre, ni tomates, ni aubergines, toutes venues d’Amérique bien après l’Antiquité.
Viandes, poissons, œufs
La viande n’était pas consommée tous les jours, mais elle faisait partie intégrante de l’alimentation, notamment lors des repas collectifs ou des fêtes.
Le porc constituait la principale source de viande, grâce à un élevage bien maîtrisé et adapté aux besoins collectifs. D'autres espèces domestiques complétaient cet apport : bœufs, moutons, chèvres, ainsi que des volailles (poules, oies, canards, pigeons), élevées à petite échelle ou en semi-liberté.
Le gibier — sanglier, lièvre, chevreuil ou cerf — était chassé de manière opportuniste, en fonction des saisons, des ressources locales et probablement du statut social. Le lapin sauvage, endémique du sud de la Gaule, pouvait être chassé et consommé ponctuellement, uniquement en Gaule méditerranéenne, où son habitat naturel le rendait accessible.
Les œufs, bien que rarement conservés dans les archives archéologiques en raison de leur fragilité, étaient très probablement consommés, notamment ceux de volaille.
Quant aux poissons, leur faible représentation dans les sites fouillés s'explique en grande partie par la mauvaise conservation des arêtes. Néanmoins, plusieurs études isotopiques sur les os humains suggèrent une consommation ponctuelle de ressources aquatiques, en particulier dans les zones fluviales ou littorales comme la vallée de la Saône, les abords de l’Atlantique ou de la Méditerranée.
La charcuterie
La transformation de la viande, notamment du porc, était une pratique maîtrisée. On trouve des traces claires de charcuterie dans les vestiges :
— le lard salé ou fumé
— des graisses fondues conservées dans des pots
— probablement des formes de rillettes rustiques ou de viande confite dans sa graisse
— et, dans certaines régions, peut-être des boudins ou préparations à base de sang et d’abats
Ces techniques permettaient de conserver la viande hors saison de chasse ou d’abattage, et participaient à l’équilibre gustatif des plats, en ajoutant du gras et du sel naturel.
Les produits laitiers
Contrairement à une idée reçue, les Gaulois utilisaient les produits laitiers, surtout dans les régions d’élevage.
Ils consommaient probablement :
— du lait de chèvre, brebis ou vache, rarement cru
— des fromages frais ou caillés, consommés rapidement
— des laits fermentés,
— et dans certains cas, du beurre, notamment au nord de la Gaule
Ces produits étaient périssables, donc peu conservés archéologiquement, mais leur usage est indirectement confirmé par des traces de matières grasses animales sur des poteries.
Fruits, fruits à coques et baies
Les fruits, qu’ils soient sauvages, semi-cultivés ou issus de vergers rustiques, occupaient une place importante dans l’alimentation des Gaulois : consommés crus, cuits, séchés ou fermentés, ils apportaient variété, goût et énergie.
Parmi les plus courants, on retrouve :
Pommes rustiques, poires sauvages, prunes, souvent cueillies sur des variétés locales, plus acides que nos fruits modernes.
Noisettes, glands doux, faînes de hêtre et châtaignes selon les régions, riches en lipides et glucides.
Raisins sylvestres (vignes non cultivées), probablement utilisés pour des préparations fermentées simples ou séchés.
Et surtout, les baies sauvages. Les fouilles archéobotaniques et les sources ethnobotaniques permettent d’en lister plusieurs :
Prunelles (Prunus spinosa) : très astringentes crues, elles étaient probablement cuites ou séchées pour accompagner des plats rustiques ou comme liant.
Baies de sorbier (Sorbus aucuparia et domestica) : utilisées après blettissement ou séchage, parfois en condiment acidulé ou pour fabriquer des boissons fermentées.
Baies de sureau noir (Sambucus nigra) : cuites ou séchées, elles pouvaient être intégrées à des bouillies ou fermentées.
Mûres (Rubus fruticosus) : cueillies en saison, consommées fraîches, séchées ou transformées.
Cynorrhodons (fruits de l’églantier) : riches en vitamine C, probablement utilisés comme pâte ou décoction.
Baies de genièvre (Juniperus communis) : très précieuses pour aromatiser ragoûts, viandes et cervoise, voire pour aider à la conservation. Leur usage est bien attesté.
Cornouilles (Cornus mas) : fruits aigres-doux consommés mûrs, parfois cuits ou fermentés.
Framboises, groseilles et myrtilles : accessibles surtout dans les zones boisées ou montagneuses, consommées fraîches ou séchées.
Azeroles (Crataegus azarolus) et autres petits fruits des haies, parfois utilisés pour faire épaissir ou sucrer un plat.
Certaines de ces baies avaient un rôle médicinal, d'autres aromatique, mais la plupart étaient avant tout des ressources saisonnières utilisées telles quelles ou intégrées à des plats simples (bouillies, pains de fruits, sauces grossières).
Herbes et aromates
Contrairement à l’image parfois austère que l’on se fait de leur cuisine, les Gaulois savaient parfaitement rehausser leurs plats avec des herbes aromatiques locales, issues de la cueillette sauvage ou de la culture domestique.
Grâce aux fouilles archéologiques, aux analyses de graines carbonisées, et à la connaissance de la flore de l’époque, on peut aujourd’hui dresser un panorama réaliste et nuancé des saveurs employées dans la cuisine gauloise.
Dans toute la Gaule, on retrouve l’usage de :
-
fenouil sauvage, à la fois pour ses graines et ses tiges parfumées,
-
serpolet (thym sauvage), abondant dans les prairies,
-
menthe sauvage, pour aromatiser boissons ou bouillies,
-
ail des ours, très commun dans les sous-bois,
-
orties, riches en minéraux, utilisées comme légume ou herbe,
-
coriandre sauvage, parfois retrouvée sous forme de graines dans des sites fouillés,
-
ainsi que des graines de pavot ou de lin, employées comme condiment ou source d’huile.
En Gaule méditerranéenne, les populations installées au sud de la Loire — et plus encore près des Pyrénées, de la Provence ou du Languedoc — vivaient au cœur d’une flore aromatique exceptionnelle, encore visible aujourd’hui dans le maquis et la garrigue.
Il est donc hautement probable, même si difficile à prouver par l’archéologie, qu’ils utilisaient aussi :
-
le romarin (Rosmarinus officinalis),
-
le laurier noble (Laurus nobilis),
-
la sauge officinale (Salvia officinalis),
-
la sarriette,
-
l’hysope,
-
l’estragon sauvage.
Ces plantes sont autochtones de la région et leur usage était évidemment connu des sociétés de cueilleurs-agriculteurs pour se nourrir, se soigner et aromatiser leurs préparations.
Les plats mijotés au chaudron — soupes de céréales, ragoûts de viande ou bouillies épaisses — étaient ainsi enrichis par ces herbes odorantes, qui jouaient le rôle d’aromates bien avant l’introduction des épices orientales.
Le sel était utilisé en petite quantité, souvent compensé par la salaison, l’usage du vinaigre doux ou la cervoise comme rehausseur de goût.
Retrouvez le goût de la cuisine gauloise !
Le Souffle de Cernunnos est un mélange d’aromates inspiré des traditions celtiques, conforme aux pratiques alimentaires attestées dans différentes parties des Gaules avant la romanisation. Il est ainsi idéal pour la cuisine au chaudron et les plats mijotés.

Je veux découvrir maintenant les Aromates des Gaules
Boissons
La cervoise, une bière rustique non houblonnée à base d’orge, était la boisson emblématique des Gaulois. Elle était souvent consommée tiède, parfois sucrée avec un peu de miel ou de fruits. L’hydromel existait également. L’eau, les infusions ou décoctions d’herbes faisaient aussi partie du quotidien.
Le vin n’était pas encore largement diffusé dans la Gaule intérieure avant l’influence romaine. Toutefois, des importations de vin étrusque et grec sont attestées dès le Ve siècle av. J.-C. dans des contextes élitaires (comme à Vix ou Lattara), notamment sous forme d’amphores et de cratères à libations.
Une cuisine au chaudron
Les Gaulois cuisinaient très fréquemment au chaudron ou dans des pots de terre sur feu de bois. Ils préparaient des bouillies de céréales, des ragoûts mêlant viande, légumes et légumineuses, ou encore des écrasées épaisses nourrissantes.
Le pain pouvait être cuit également au chaudron, sur un lit de feuilles ou de paille, ou aussi sous forme de galette dense. Contrairement à la cuisson du pain, qui exige un feu vif et un chaudron très chaud, les plats du quotidien étaient mijotés lentement sur des braises, autour de 95 degrés.
Une cuisine sobre, rustique et savoureuse
Loin des fantasmes ou du folklore, l’alimentation gauloise était équilibrée et étonnamment riche.
Revenir à cette cuisine aujourd’hui, c’est redécouvrir des gestes anciens, une sobriété juste, et un goût profondément ancré dans le vivant.
Vos coffrets de recettes Gauloises au chaudron sont disponibles en ce moment sur le site !
Vous y trouverez également tout le matériel nécessaire pour vous lancer dès maintenant.
Où se procurer des céréales et des légumineuses anciennes ?
Pour retrouver les saveurs authentiques de la cuisine gauloise, il est essentiel d’utiliser des céréales et des légumineuses issues de variétés anciennes, cultivées en agriculture biologique.
Plusieurs filières proposent aujourd’hui ces produits, notamment des moulins, coopératives bio et petits producteurs spécialisés.
Parmi eux, Moulin des Moines, en Alsace, occupe une place importante dans la valorisation des céréales bio.
Entreprise familiale pionnière du bio depuis les années 1970, elle transforme également les grains selon des méthodes traditionnelles, notamment grâce à la mouture sur meules de pierre.
Pour vous procurer facilement vos céréales et légumineuses bio vous pouvez visiter leur site : Moulin des Moines

Pour aller plus loin :
– Jean-Louis Brunaux, Les Gaulois (Les Belles Lettres, 2018)
– Christian Goudineau, Regards sur la Gaule (Seuil, 2001)
– Venceslas Kruta, Les Celtes. Histoire et dictionnaire (Robert Laffont, coll. Bouquins, 2000)
– Jean-Paul Savignac, Alimentation et cuisine des Gaulois (Errance, 2004)
– Brigitte Lion & Jean-Marie Durand (dir.), Les pratiques alimentaires dans les sociétés anciennes (La Découverte, 2014)